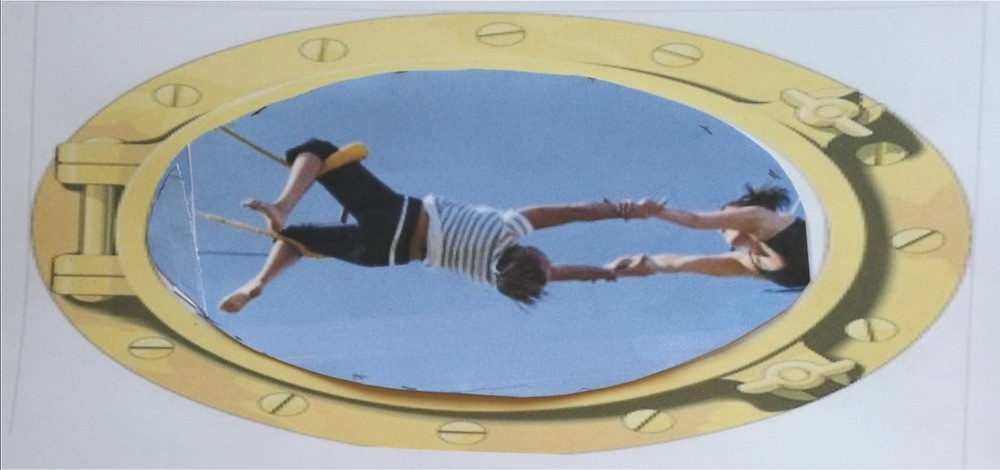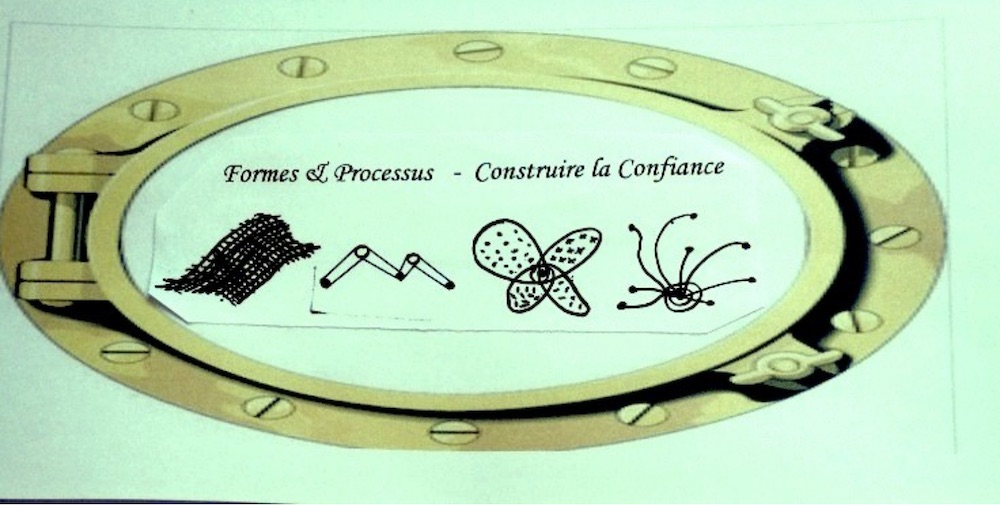par Dominique Rey
La Confiance ! Serait-ce le vrai nerf de la guerre ? Des opérations de maintien de la paix ? En tous cas de la coopération, comme d’ailleurs de tant de choses humaines : politique, économie, projets, traitement des crises… Mais quels en sont les ingrédients – selon les sociétés et les cultures ?
La confiance, notion probablement traduisible dans toutes les langues, désigne un fait anthropologique universel, inhérent à l’existence humaine. Comme d’ailleurs à celle de bon nombre d’espèces animales, dont elle est un ressort essentiel de la vie en société et de la capacité à coopérer entre eux – et avec les humains dans le cas des animaux domestiques.
Autant dire que tout Humain en capte et en porte intuitivement la signification. Reçue ou accordée, la confiance intervient en permanence dans nos vies professionnelles comme privées. Vis-à-vis de personnes[1], et même d’institutions ! Mais de quoi est-elle faite ? Si j’essaye d’analyser notre vécu de l’état de confiance, j’y trouve rassemblées trois composantes : un sentiment, une croyance ou supposition, et une attitude. Chacune touche à un niveau essentiel du fonctionnement humain : le niveau émotionnel où l’on ressent, le niveau cognitif où l’on raisonne et suppute, et le niveau de l’action où l’on s’engage concrètement.
La conjonction de 3 composantes :
- C’est d’abord un sentiment de sympathie et de proximité humaine, ou simplement de sécurité par rapport aux intentions et comportements de l’interlocuteur (personne ou institution) : on se sent avec cette personne plutôt à l’abri d’une mauvaise surprise tant dans ses actes que dans ses intentions. Parce que c’est lui ou elle, parce que c’est ainsi que je le ou la perçois, très intuitivement.
- Ce sentiment est par nature éminemment subjectif, mais il est souvent étayé sur une supposition : la présomption que l’autre est de bonne volonté vis-à-vis de nous et n’a pas de raison ou d’intention de nous nuire. Qu’il n’a pas d’intérêt évident à le faire. Qu’il est même plutôt dans ses intérêts ou sa logique de nous aider dans nos démarches… jusqu’à preuve du contraire. C’est le niveau cognitif.
- Et le tout détermine en soi une attitude d’ouverture à l’autre, et plus précisément d’acceptation d’un risque : celui de s’être trompé sur cette idée et cette impression de relative sécurité, et de se voir finalement abusé et trahi.
Comme on le sait, la conjonction de ces trois composantes ne se produit pas avec tout interlocuteur. Cependant, chaque société comporte – intégré dans sa culture – un moyen courant de faciliter la chose, même entre des personnes ne se connaissant pas.
Dans un article publié le 15-1-2020 sur le site du Club de l’Interculturalité, j’ai montré comment les sociétés humaines se répartissent selon les logiques sociales activées pour cette facilitation : soit le cadre fourni par un tissu serré de règles impersonnelles s’appliquant à tous, soit l’activation d’une chaine de liens « naturels » et familiaux, soit par des relations choisies constituant un réseau de soutien mutuel à la chinoise. Pour être complet, il faut y ajouter un quatrième mode : celui peu ou prou adopté par les autres sociétés asiatiques qui, comme l’Inde, la Corée et le Japon cultivent la solidarité et la confiance dans des cercles d’appartenance volontaire ou de métier, de religion ou d’entreprise.
Les quatre modèles de sociétés
Un premier modèle est celui des sociétés occidentales : les lois, règles et contrats écrits sécurisent et rendent prévisibles les comportements, créant un premier socle de confiance.
Les sociétés patriarcales et claniques misent au contraire sur la relation familiale, élargie selon les besoins au village, à l’ethnie ou la religion. Ces liens « naturels » créent une chaine transitive apportant aides, protections et préférences dans toute situation incertaine ou délicate.
En Asie, au-delà du rôle central de la famille, c’est l’appartenance à un ou plusieurs cercles qui va jouer : l’Inde conserve plus que des traces de son ancien système de castes et de jâti. Le Japon, la Corée[2] ont aussi leurs systèmes de groupes, réseaux ou rituels de sociabilité destinés à assurer une solidarité forte et un bon niveau de confiance en intra-groupe.
La société Chinoise (continentale ou de la diaspora), également très axée sur la famille, a développé un modèle particulier de relations choisies de personne à personne, soigneusement entretenues par des échanges réguliers de dons, gratifications, aides et protections. Ces relations apportent une confiance précieuse dans une société par ailleurs peu régulée.
Ainsi, selon les sociétés, les facteurs qui sous-tendent cette « confiance a priori », et le processus par lequel elle se construit sont-ils très différents, comme on le voit avec ces quatre grands types d’approches : par les règles, une chaine de liens « naturels », des cercles d’appartenance ou les relations choisies.
Chacun de ces modes avec ses avantages et inconvénients imprime sa marque sur les styles de coopération typiques des diverses parties du monde, du plus universel – mais sans doute plus superficiel et fragile – au plus particulier, souple et robuste.
Quel usage faire de ces constats ? D’abord mesurer la diversité des modes de fonctionnement des sociétés, sortir s’il en est encore besoin de vues ethnocentrées, et mieux connaître les logiques sous-jacentes aux grandes aires culturelles avec lesquelles on est amenés à travailler ou voyager. Mais ce sont aussi des clés importantes par exemple pour un occidental expatrié dans une autre aire : parvenir à se glisser dans le processus de construction de la « confiance de principe » ayant cours dans cette société facilitera et accélérera considérablement son insertion dans celle-ci.
C’est particulièrement fréquent en Chine, car un étranger implanté là pour son travail ne manquera pas d’être sollicité par des Chinois pour établir une relation de confiance selon la logique du guanxi : un échange alterné entre les deux “amis“ de cadeaux, soutiens, contacts, gratifications et apports de face. L’un des deux aura pris l’initiative d’un don, auquel l’autre répondra par un autre don pour montrer qu’il accepte la relation ainsi proposée. Régulièrement entretenue, cette relation qui n’a pas besoin d’être égalitaire est un puissant ressort de développement et de protection dans un monde chinois fort peu régulé.
De même, dans un pays de culture familialiste-clanique, connaître quelqu’un (local ou même étranger) disposant d’une notoriété et d’un fort ancrage social, peut permettre plus qu’un préjugé favorable : de véritables entrées et une forte présomption d’être soi-même digne de confiance.
Il suffit d’aller en Corse – enclave clanique dans la société française universaliste et légaliste – pour vérifier comme les portes s’ouvrent sur un accueil chaleureux pour peu qu’on puisse se recommander d’une famille locale.
Bien sûr, ces considérations n’épuisent pas le sujet de la construction de la confiance.
En particulier, nous n’avons pas abordé le cas d’une relation de travail entre deux professionnels de cultures différentes, qui ne relèverait d’aucun des processus de mise en confiance que nous venons de voir. Ce sont des situations extrêmement courantes où les deux interlocuteurs auront à ajuster mutuellement leurs manières de voir et leurs comportements. L‘établissement d’une confiance réciproque sera d’autant plus importante pour l’efficacité et le succès de leur interaction que la différence des cultures ne manquera pas de produire quelques malentendus, frictions ou incertitudes qu’ils auront à désamorcer et surmonter.
Dans un prochain article, nous analyserons ces situations – interculturelles au sens propre — et verrons comment la confiance peut malgré tout s’y établir.
[1] Il n’est question ici ni de la confiance en soi, ni de la confiance en l’avenir (ou le salut) [2] Benjamin Pelletier analyse ces relations de confiance horizontales cultivées dans une société coréenne par ailleurs très hiérarchique, dans son excellent blog « Gestion des Risques Interculturels ».Pourquoi et comment accorde-t-on sa confiance ?
C’est le sujet que j’ai essayé de clarifier quelque peu, dans l’article précédent (publié le 26 mars) :
En observant, pour résumer à l’extrême, que la confiance est la superposition de trois composantes : l’une très subjective (un sentiment, une intuition), l’autre raisonnée (une supposition), et la troisième qui en résulte et qui dispose à agir, à prendre le risque d’être déçu voire trahi (une attitude optimiste).
Et en constatant que les sociétés humaines présentes actuellement autour du globe s’étaient dotées de pratiques facilitant l’établissement entre leurs membres de liens de confiance ; ce qui est bien utile notamment pour des professionnels, qui en ont hautement besoin pour établir entre eux des coopérations efficaces. L’observation de ces dispositions fait apparaître quatre modèles principaux, fort différents : l’un s’appuyant sur le système de règles qui encadre fortement les comportements en Occident, un autre (en Afrique, dans le monde arabe et musulman) misant sur les liens familiaux et claniques, un troisième fondé sur l’appartenance à de multiples cercles (comme en Corée), et un quatrième consistant à nouer des relations choisies, continuellement entretenues par des dons réciproques (typiques de la culture chinoise).
Mais ces mécanismes très utiles s’appliquent à l’intérieur d’une société donnée. Y compris lorsqu’un étranger suffisamment bien (in)formé parvient à en faire jouer les ressorts au profit de sa bonne et prompte intégration dans la société d’accueil.
Bien évidemment, entre personnes issues de sociétés différentes, ces modes codifiés et balisés de construction de la confiance sont a priori désamorcés. Ces professionnels ont pourtant besoin de confiance pour travailler ensemble, situation interculturelle au sens propre et de plus en plus courante. La confiance leur est d’autant plus nécessaire que n’ayant pas la même culture ils doivent s’attendre à quelques incompréhensions, divergences et agacements au fil de leur coopération.
On sait qu’établir une véritable confiance alors qu’on est porteurs de deux cultures différentes n’a rien d’évident – mais que beaucoup y parviennent néanmoins ! Comment font-ils et peut-on s’en inspirer ?
Je n’ai vu jusqu’à maintenant aucune étude sur ce sujet (toutes suggestions sur ce point seront bienvenues !). Les ouvrages de management font grand cas de la confiance, mais sans expliquer comment on la suscite, a fortiori en situation interculturelle. Il serait évidemment très intéressant d’ouvrir cette « boite noire » : de travailler sur des cas concrets pour comprendre quel a été leur processus de mise en confiance et les facteurs qui y ont contribué.
En attendant de disposer d’un tel recueil d’expériences opérationnelles, au moins peut-on formuler quelques conditions de succès : on peut pour cela s’appuyer sur la définition de la confiance rappelée en début de cet article, en se demandant comment activer ses trois composantes, à commencer par l’appréhension “objective“.
Objectivement : quelles bonnes raisons de s’engager ?
Prenons l’aspect cognitif : quelles bonnes raisons ai-je (et a-t-il) de faire l’hypothèse qu’il n’y aura pas déception ? Il faudra sans doute que chacun démontre d’abord sa compétence, ou en donne des indices en évoquant des expériences convaincantes.
Que chacun montre aussi qu’on sera capable d’élaborer ensemble, donc d’écouter, de répondre, de proposer des idées, des analyses, des réponses, d’affirmer mais aussi de réserver ou modifier une opinion : de tout cela – qui présage de la capacité de travailler et communiquer ensemble, chacun devrait donner des échantillons et des signes dès les premiers échanges.
Cela suppose aussi de comprendre et faire comprendre les intérêts et les rôles dont chacun a la charge : mentionner ses objectifs, ses contraintes et ses limites – et être très attentif aux échos et réactions à ces énoncés : y aurait-il des dissonances, des contradictions dans nos intérêts ? S’il y en a, est-on capables d’en parler ouvertement et de voir comment les contourner, ou « faire avec » ? Il s’agit bien de vérifier si les intérêts et les rôles sont sinon convergents ou parallèles, du moins compatibles, dans certaines limites, mais aussi que chacun est prêt à jouer cartes sur table, que les positions respectives sont claires et qu’on peut en parler.
À moins bien sûr qu’on soit dans une démarche de ruse, dissimulation ou manipulation, auquel cas la construction de la confiance se joue sur un échiquier très différent de celui d’une coopération confiante que nous cherchons ici à décrire.
Et justement : attention aux (petits) mensonges ! Ils n‘ont pas le même statut selon les sociétés. Même véniel, le mensonge est très mal vu dans l’aire anglo-saxonne et nordique, et ruine la crédibilité de son auteur, donc la confiance. Alors que les sociétés de tradition catholique, dont la française, jugent selon l’enjeu et la “gravité“. Et ne prêtent guère attention aux petits mensonges d’excuse ou de confort. Qui peuvent ainsi ruiner d’un coup la confiance d’un interlocuteur étranger, selon sa culture. D’autres cultures ont des usages et des jugements encore différents : une raison de plus de s’en informer et d’en comprendre les logiques.
Subjectivement : reconnaître l’autre et accepter de se dévoiler un minimum
Comment faire pour établir un sentiment mutuel de sympathie et de proximité humaine ? Du moins peut-on en réunir des conditions favorables. Et d’abord en prêtant attention à la personne pour établir une vraie rencontre : avec une personne et non pas seulement une tâche, un dispositif ou un robot.
C’est pourquoi dans beaucoup de cultures on n’aborde pas une relation d’affaires importante sans avoir pris le temps d’un dialogue de personne à personne, où les enjeux du travail ou de la négociation sont ostensiblement laissés de côté pour parler sur un plan humain et personnel : a-t-on une famille, des enfants, un intérêt pour le football, une perception personnelle du pays. Il s’agit de démontrer que « l’on n’est pas un robot », que l’on existe vraiment ; que l’on n’est pas insensible, mais un être de sentiments et de dignité ; que l’on est curieux de notre prochain, que l’on accepte de prendre le temps de se montrer et de s’ouvrir à l’autre. Qu’on ne le prend pas, lui, comme un objet, mais comme un sujet qui compte, y compris dans sa subjectivité et sa marge de liberté et d’appréciation, choses dont on aura besoin pour faire du bon travail ensemble. Bref, qu’on le respecte.
Il se peut qu’un courant de sympathie réciproque se forme d’emblée, spontanément, sans qu’on puisse dire précisément comment. Parfois du fait d’échos entre les identités, de projections, d’effets de séduction mutuels. Mais plus souvent ce sentiment est le résultat du processus d’échange, qui à partir d’une attention et d’une estime réciproques apporte une sécurité et un confort bienvenus dans l’interaction, voire une complicité à surmonter ensemble leurs différences culturelles d’expression. Le sentiment d’être considéré et reconnu dans ce que l’on est, respecté, pris au sérieux, est un pas essentiel pour mettre chacun à l’aise et dans une certaine sécurité émotionnelle.
Évidemment, l’arrogance, la condescendance, l’impatience, un excès de familiarité ou de distance (délicat cependant à apprécier entre cultures), ou encore le manque d’écoute sont à l’inverse fatals à la sympathie. Mais une attitude de dépendance, où l’un ne sait pas se poser en interlocuteur solide tenant bien son rôle, peut l’être également.
Au demeurant, la relation n‘a pas besoin d’être égalitaire, et le sentiment de confiance peut très bien naitre d’une relation d’autorité, d’un ascendant ou d’un leadership de l’un des acteurs, induisant chez l’autre un sentiment de sécurité et de protection. Mais un manque visible de sincérité, de spontanéité, un discours ambigu ne pourront qu’alimenter le soupçon de duplicité et d’hypocrisie, désamorçant la possibilité d’une bonne perception de l’interlocuteur.
Une attitude positive et ouverte
La troisième composante de la confiance, l’attitude, a quelque chose d’auto-réalisateur, ou du moins qui porte à la réciproque. Dans une situation interculturelle de coopération (comme d’ailleurs de négociation ou commerciale), un enjeu important, à la fois cause et conséquence de l’établissement de la confiance, est la bonne volonté et la capacité de surmonter les différences et difficultés liées aux cultures d’origine des partenaires.
Certains disent que la confiance vient avec l’habitude. Si tant est que ce soit vrai, encore faut-il « amorcer la pompe ».
La meilleure clé pour le faire est une attitude favorisant le traitement en souplesse et en positif des différences, qui va en retour consolider la bonne volonté réciproque et la confiance : d’abord la reconnaissance de l’égale valeur et cohérence de chacune des cultures – inutile de chercher une hiérarchie entre sociétés ! Ensuite ne pas voir ces différences simplement comme des obstacles ou des freins. Car l’observation des autres cultures est doublement instructive : en révélant nos propres évidences et biais ; et en nous ouvrant à d’autres manières de penser et de faire, potentiellement fructueuses, même dans notre système. Et puis une attitude pragmatique, constatant les divergences et la nécessité de s’accorder, de se rendre prévisible et compatible ; de coopérer pour trouver ensemble comment s’ajuster de façon pertinente aux situations.
En bref il s’agit d’une attitude d’ouverture à d’autres manières de faire, de vigilance pour repérer les différences et éviter les erreurs et malentendus, et de recherche conjointe de solutions pour traiter ces différences. C’est évidemment essentiel en contexte interculturel, aussi bien dans un binôme que dans une équipe mixte.
Sans oublier l’importance des feedbacks bienveillants, si possible élogieux sans être outrés et artificiels. Mais là encore, attention à l’ethnocentrisme : les compliments comme les cadeaux ne sont pas perçus de la même manière dans toutes les cultures ; certaines gratifications peuvent mettre dans l’embarras, rendre difficile la réciproque, éveiller les jalousies voire attirer le mauvais œil…
Des processus typiques et des cas concrets !
Voilà pour les conditions générales. Valables aussi en situation d’équipe multiculturelle.
Il faudrait pouvoir aller plus loin, décrire des cas concrets et identifier des processus typiques. De ce que cette analyse de cas de terrain peut apporter, on peut déjà donner quelques exemples :
- Comme déjà observé, l’habitude de travailler de concert rend prévisible, et c’est un facteur de confiance (à condition que l’agacement ou les griefs ne prennent pas le dessus). Il y a mieux : une première expérience d’avoir vécu au coude-à-coude des épreuves, un challenge ; a fortiori d’avoir réussi ensemble (à condition d’en être gratifié selon sa contribution).
- On peut aussi découvrir que travailler ensemble génère une qualité émergente, ce qui donne évidemment de la valeur au compagnonnage et au partenaire, et une complicité appréciable.
- Apporter une aide inattendue (ou souhaitée), donner un coup de main bienvenu, avec la discrétion appropriée, ou simplement faire de petits gestes de gentillesse ou de prévenance est une manière de tendre la perche et suggérer une relation de bienveillance réciproque. Ce peut d’ailleurs être un bon test de la réaction de l’autre.
- Rire ensemble est aussi un excellent levier de sympathie, si l’on peut trouver l’occasion et le bon canal de communication avec l’interlocuteur ; ce qui n’est pas facile en interculturel, et suppose souvent le problème de la confiance déjà résolu.
Je ne voudrais pas clore cet article sans donner des exemples plus spécifiquement culturels de ces processus pratiques. En voici deux :
- Celui de ce manager français expatrié au Maroc pour diriger une équipe, et qui la trouve froide et passive. Jusqu’à ce qu’il comprenne « qu’ils voulaient une relation affective, que je sois un peu leur père ». Il explique que tout s’est dégelé lorsqu’il l’a compris et s’est impliqué dans une supervision beaucoup plus forte et proche, endossant un rôle paternel qu’il n’aurait jamais songé à prendre avec ses équipes françaises précédentes[1].
- Une découverte que j’ai moi-même faite au cours d’un voyage en Syrie, à une époque moins dramatique qu’aujourd’hui. Étranger au pays, je ne pouvais entrer dans le processus de recherche d’un lien indirect “clanique“ tel que déjà décrit. Mais je me suis aperçu que mes divers interlocuteurs au fil du voyage me soumettaient systématiquement à une sorte de test[2] : ils s’arrangeaient pour me demander de me placer, sur un sujet ou un autre pas trop important, entre leurs mains – de me confier à eux ; de prendre – à l’aveugle – le risque de suivre leur conseil, de compter sur eux pour une démarche, etc. J’ai fini par comprendre que ce n’étaient qu’autant de prétextes pour vérifier, sur un détail significatif, ma capacité à leur accorder ma confiance – auquel cas mon interlocuteur local me donnait immédiatement la sienne, et beaucoup de dévouement, voire d’amitié. C’était un test sur la capacité de l’étranger de percevoir la valeur de la confiance…
À partir de témoignages et d’études de cas bien détaillés, on devrait pouvoir découvrir encore bien d’autres processus de construction de la confiance en situations interculturelles. Mettons-les en commun !
[1] Cité dans « Gestion en contexte interculturel » Davel-Dupuis-Chanlat (PUL 2008) [2] cas développé dans mon livre « Management & Communication Interculturels » (Afnor Éditions, 2017)